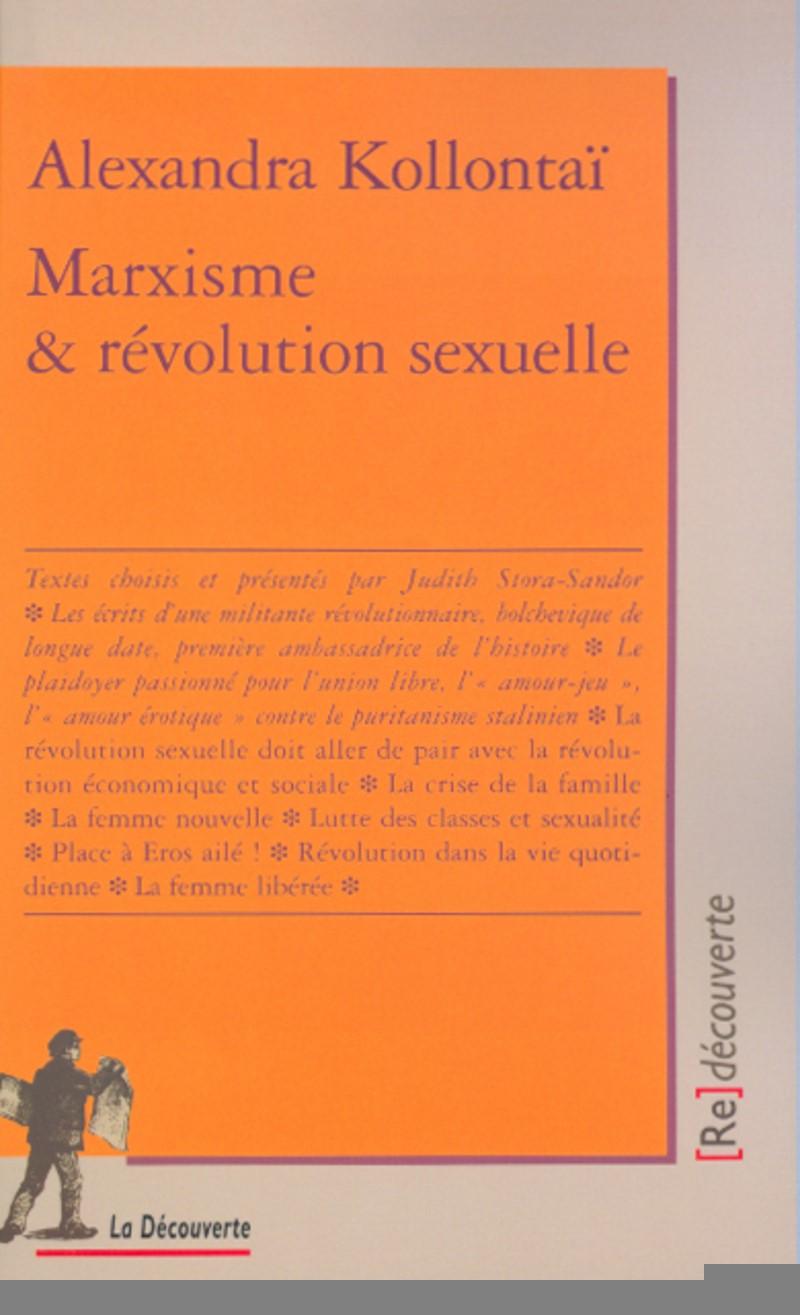
Alexandra Kollontaï, Marxisme et révolution sexuelle, La Découverte, 2001, textes originaux 1909-1923, 283 pages. Dispo aux rayons Pensées Radicales-Critiques Sociales: Féminisme-Critique Patriarcat
Marxisme et révolution sexuelle est un recueil de textes écrits par Alexandra Kollontaï entre 1909 et 1923, introduits et présentés par Judith Stora-Sandor. Ces textes sont de format divers, allant de l’article de presse politique, à la conférence ou encore à la nouvelle littéraire. Ils ont pour sujet principal la question de l’émancipation des femmes, de l’amour et de la révolution.
Alexandra Kollontaï (1872-1952) est une révolutionnaire socialiste russe devenue bolchévik en 1915. Elle participe à la révolution russe et est favorable à la « révolution » d’octobre qui acte la prise de pouvoir progressive du parti bolchévique. Kollontaï devient alors commissaire du peuple à la sécurité sociale. Dans les années 1920 elle est aussi responsable du secteur féminin pour l’organisation des ouvrières au sein du parti communiste russe. Rapidement critique de la politique du parti, Kollontaï finit par rejoindre en 1921 l’Opposition ouvrière au sein du PCUS. Cette opposition interne, bien que ne remettant pas en cause le monopole du pouvoir par le parti bolchévique, dénonce sa bureaucratie et réclame plus d’autonomie pour les syndicats, l’établissement d’un vrai contrôle ouvrier sur la production. À partir de 1923-1924, Kollontaï est diplomate pour le compte de l’URSS en Norvège, un début de carrière diplomatique qui traduit une volonté de l’éloigner pour ses prises de position critiques. Diplomate efficace, restée relativement fidèle aux « intérêts » soviétiques, elle réussira à échapper aux diverses purges staliniennes et arrête sa carrière en 1945.
I] Résumé des conceptions de A.K
L’idée principale qui sous-tend les analyses de A. K. est la suivante: la révolution sexuelle doit être liée à la révolution sociale, elles sont complémentaires et inséparables. Vis à vis des questions féminines, elle est influencée par la pensée marxiste de son temps, notamment par L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’état de Engels1 et La femme et le socialisme de Bebel2. Partant de ces influences, Kollontaï s’attache à analyser les rapports sociaux sexués. De cette analyse, elle souhaite élaborer une théorie et une pratique qui permettraient la subversion des rapports de domination entre les hommes et les femmes.
Avant toute chose, pour Kollontaï, le problème des rapports inégalitaires entre hommes et femmes est lié à l’institution familiale patriarcale. Elle définit cette structure familiale comme bourgeoise, en partie héritière et successeuse des structures familiales propres aux sociétés féodales. Le fonctionnement et l’histoire de ce modèle familial vont de pair avec le capitalisme industriel. En effet, pour A. K. et les marxistes en général, la structure familiale bourgeoise est liée à l’accumulation capitaliste primaire et à la notion de propriété privée. En gros, cette structure familiale permet, par l’instauration de la propriété privée et via l’héritage, l’accumulation et la transmission du capital. Elle est donc un des éléments qui permet la propriété privée des moyens de production, une des caractéristiques déterminantes du pouvoir de la bourgeoisie en tant que classe dominante.
Pour justifier ce fonctionnement, toute une série de normes et de codes moraux se développent. Cette morale, celle de la classe au pouvoir, devient progressivement hégémonique et s’impose alors dans toutes les classes, peu importe leur place dans la hiérarchie sociale. En pratique, cela se traduit par un asservissement familial légalisé au profit du père et du mari, au détriment de la femme qu’elle soit fille ou mariée. La morale, l’idéologie et la loi assignent ainsi des caractères et des rôles à la femme qu’elle doit endosser pour la perpétuation de la famille et de l’ordre marchand. Cette situation touche d’ailleurs, selon K., les femmes de toutes les classes sociales. Mais, la prolétaire, à la différence de la bourgeoise, subit elle un double asservissement : moral/sexuel et économique.
A.K. analyse aussi les contradictions et les évolutions induites par le capitalisme dans les rapports entre les sexes. Ainsi, pour elle, le modèle de la famille bourgeoise, dans toutes les classes sociales, est soumis à différentes pressions et mutations liées à l’évolution des rapports de production. Par exemple, elle observe que le rôle de conservation des richesses, dévoué à la famille, est de plus en plus transmis à des institutions telle que des banques ou autres agences au fur et à mesure que le capitalisme se développe. De même, l’existence du prolétariat remet aussi en cause le modèle familial classique. Tout d’abord car l’exploitation des prolétaires et leurs conditions de vie misérables font péricliter la stabilité même de la famille alors que celle-ci se doit d’être une institution durable et ordonnée.
Ensuite, le besoin de main d’œuvre des capitalistes pousse de plus en plus de femmes sur le marché du travail. L’accès au travail de ces femmes les rend potentiellement moins dépendantes des hommes. De même, du fait de leur situation de prolétaire, ces femmes prennent place dans les luttes de classe modernes. Dès lors, elles peuvent davantage être perçues comme des camarades et des êtres humains par leurs camarades masculins que comme des « femmes » avec tout ce que cette perception et ce processus d’essentialisation entraînent en terme de division des tâches et donc d’inégalité.
Par ailleurs, toutes ces évolutions du début XXe siècle, conduisent un nombre croissant de femmes à avoir de nouvelles aspirations. Pour K., ces femmes souhaitent affirmer leur personnalité et protestent de plus en plus contre leur triple asservissement dans l’état, la famille et la société. Dès lors, elle estime que leurs aspirations sont dans l’intérêt du mouvement ouvrier:
« Le nouveau type de la femme, intérieurement libre, indépendante, correspond à la morale qu’élabore dans l’intérêt de sa classe, le milieu ouvrier. La classe ouvrière pour l’accomplissement de sa mission sociale, a besoin non d’une esclave impersonnelle du mariage, de la famille, possédant les vertus passives féminines, mais d’une individualité soulevée contre tout asservissement, d’un membre conscient, actif et jouissant de tous les droits de la collectivité, de la classe. » (p. 132).
Pour toutes ces raisons, K. pense que le combat pour l’abolition des classes et pour l’émancipation féminine est lié. Partant de ce présupposé, elle s’attache également à critiquer la vision de l’émancipation des femmes portée par les féministes de son époque. En parallèle, elle développe un point de vue assez intéressant sur la question de l’amour.
Sa critique vise principalement une des revendications principales des féministes de gauche: l’union et l’amour libre. Pour ces militantes, l’union libre permettrait une libération morale de la femme car le mariage va à l’encontre de leurs intérêts en tant que sujet qui désire plus d’autonomie. Bien que Kollontai adhère à l’idée de l’union et de l’amour libre comme une des bases de rapports égalitaires entre les sexes, elle pense aussi que, dans une société de classe, sa réalisation effective paraît idéaliste. Au mieux, comme idéal et pratique, il peut permettre d’inspirer les femmes dans leur recherche et leur volonté d’émancipation. Mais, pour A.K, l’union libre doit aller de pair avec une réforme voire une abolition de la famille et de la répartition des tâches qui lui est lié (travail ménager, éducation-responsabilité des enfants). Par conséquent, si l’union libre commençait à être réalisé sans remettre en cause le cadre capitaliste et patriarcal, cela pourrait en partie aller à l’encontre des intérêts de certaines femmes, notamment des femmes prolétaires puisque la division sexuelle du travail et ses implications matérielles ne sont pas fondamentalement remises en cause.
De plus, la psychologie des êtres humains sous le capitalisme ne permet pas ou peu d’envisager un amour libre effectif. En effet, pour A. K., l’homme du capitalisme n’est pas prêt à ce genre de rapport, ses relations affectives/ sexuelles se caractérisent par un droit de propriété sur le corps et l’âme du partenaire, conceptions qui conduisent, entre autres exemples, à des sentiments d’abandon et de solitude lors des ruptures ou à de la jalousie dans les relations. De même, la culture bourgeoise avec tout ses préjugés, conditionne le comportement des hommes dans les rapports amoureux, les amenant à être dans l’autosatisfaction au détriment des femmes dont l’individualité, la personnalité, est le plus souvent niée.
En conséquence, Kollontaï estime que:
« seules une série de réformes radicales dans le domaine des rapports sociaux, réformes par lesquelles les obligations de la famille seraient reportées sur la société et l’état, créerait le terrain favorable sur lequel le principe de l’amour libre pourrait dans une certaine mesure se réaliser. » (p. 83). Et qu’en somme il faut s’attaquer « aux causes qui ont déterminé la forme actuelle du mariage et de la famille » (p.85).
Dès lors, A.K. s’applique à penser de nouveaux rapports entre les hommes et les femmes. La recherche et l’édification de ces nouveaux rapports doivent aller de pair avec la lutte pour la réappropriation communiste des moyens de production, avec une révolution sociale. Ainsi, elle souhaite développer une nouvelle morale sexuelle et relationnelle qui doit permettre l’épanouissement d’un véritable amour libre.
Le but étant, d’arriver à une
« rééducation fondamentale de la psychologie, rééducation qui n’est réalisable [encore une fois] que par la transformation de toutes les bases sociales qui conditionnent le contenu moral de l’humanité. » (p. 163, Meisel-Hess cité par A.K).
Néanmoins, cette amour-libre ne doit pas seulement s’appuyer sur des réformes sociales mais aussi sur une grande créativité qui peut accroître le potentiel d’amour au sein de la société. En effet, la penseuse accorde un rôle psycho-social de premier ordre à l’amour. Celui-ci permet le développement de la solidarité et de la coopération qui sont notamment les principes élémentaires d’une société communiste. L’amour libre elle l’envisage aussi comme un apprentissage qu’elle qualifie d’amitié érotique ou amour-jeu, une sorte d’école relationnelle pour arriver au « grand amour » dans l’humanité. Pour Kollontaï:
« ce n’est qu’après avoir passé par l’école de l’amitié amoureuse que la psychologie de l’homme sera apte à accueillir le grand amour, purifié de ses côtés sombres. » (p. 165).
Cet idéal pratique est exigeant. Il se base sur le respect de la personnalité et la reconnaissance mutuelle, demande de l’attention et de la délicatesse pour s’opposer à l’égoïsme car:
« l’idéologie du prolétariat ne peut admettre la soumission de l’un à l’autre, l’inégalité même dans les rapports amoureux » (p. 144).
De plus, l’amour-jeu implique de ne pas se donner entièrement tout de suite à un autre individu, d’expérimenter. Enfin, même si l’idéal relationnel de A.K. reste « l’union monogamique fondée sur un grand amour » (p. 167, Meisel Hesse cité par A.K), elle l’envisage toute de même comme quelque chose de variable, qui n’est pas figé dans le temps. De même, l’amour-jeu comprend tout une gamme d’union entre les sexes qu’il s’agit de reconnaître, des relations non basées sur l’amour absolu et possessif, ni simplement sur une « brutale sexualité réduit à l’acte physiologique ». (p.164).
Pour A.K cette école de l’amour permet donc de substituer à des rapports de subordination et de possession des relations basées sur la camaraderie. Plus tard, dans un texte aux teintes nettement plus léninistes, elle estime que:
« plus il y aura de fils ainsi tendus d’âme à âme, de cœur à cœur, d’esprit à esprit, plus l’esprit de solidarité s’enracinera solidement et plus aisée sera la réalisation de l’idéal de la classe ouvrière: la camaraderie et l’unité » (p. 200).
II] Perspectives et critiques
Nombre des réflexions de Alexandra Kollontaï peuvent être intéressantes pour penser et mettre en pratique un projet d’émancipation plus actuel du capitalisme et des divers patriarcats bien qu’il apparaît aussi nécessaire d’en souligner les limites.
Premièrement, la méthode ou la vision du monde marxistes de Kollontaï lui permet d’avoir une analyse assez conséquente des rapports sociaux sexués. La méthode matérialiste qui consiste à analyser et à historiciser les contradictions de la société, de penser tout simplement la société en terme de rapports dynamiques, est souvent pertinente. Mais, la vision du monde marxiste, malgré l’avantage d’une bonne méthodologie, n’empêche pas certaines « faiblesses ». Ces manquements sont visibles notamment dans son exposé des bouleversements de la famille que provoquent le développement du capitalisme. Dans cette analyse A.K a parfois une lecture peut-être un peu trop « linéaire » ou « automatique » des évolutions sociales. Cette lecture est souvent propre aux penseurs marxistes de ce temps qui, influencés en partie par Engels, tendent à des interprétations « évolutionnistes » et « automatistes » du type: le développement des forces productives3, induit par le développement du capitalisme, créent les conditions (plus ou moins idéales) pour la socialisation des moyens de productions et donc la révolution prolétarienne.
Par exemple, A. K. pense que certaines prérogatives de la famille sont progressivement prises en charge par l’état lors du développement capitaliste. L’école, les crèches, cantines etc sont de plus en plus développées et permettent donc une dissolution partielle de la famille bourgeoise. En parallèle, elle pense que l’accroissement du travail féminin amène les femmes a potentiellement plus d’indépendance. L’analyse est en partie vraie mais une chose qui n’est pas ou peu montrée par A.K c’est que nombre des institutions qui entendent se substituer à la famille et au travail de la femme sont des secteurs de travail composées surtout de femmes.
Or, socialiser le travail/l’activité des femmes en le sortant de la famille mais en conservant son caractère féminin, par la composition des travailleurs ou l’organisation et la fonction même de la dite activité, cela n’amène pas forcément à une disparition de la famille et à la fin de la domination masculine. Non, cela conduit même potentiellement à une concentration de la cellule familiale en diverses institutions voire à son « étatisation ». Son caractère privé devient alors « public » et peut jouer contre l’intérêt des femmes, la domination sous la pression du capital, ayant juste changer de forme.
L’idée la plus pertinente des conceptions de A.K reste celle qui sous tend tout le bouquin, à savoir que la révolution communiste doit aussi être une révolution sexuelle (et vice-versa).Bien que datées, puisque nous ne ne sommes plus dans la même société et que nombre de théories et d’analyses sur les questions de genre ont vu le jour, ses réflexions restent selon nous pertinentes.
En effet, tout projet d’émancipation radicale doit viser à la destruction du capitalisme, des divers patriarcats et à la subversion des normes de genre. Car, ces systèmes, à l’échelle du globe et selon diverses modalités, s’interpénètrent toujours même si cela se fait de manière différente qu’à l’époque de A.K. Il est nécessaire de rappeler cet objectif de la révolution à un moment où de nombreuses luttes radicales, tant par leur conduite que leurs objectifs, voient le jour contre divers pouvoirs économiques, étatiques et patriarcaux dans le monde. Enfin, il apparaît aussi nécessaire de réaffirmer cet objectif car actuellement certaines luttes contre le patriarcat et les normes de genre, tendent en parallèle à une volonté d’intégration au système libéral bourgeois dans divers pays.
De même, les conceptions d’A.K sur l’amour libre sont toujours en partie d’actualité. Elles sont encore inspirantes pour envisager ce que peuvent être nos rapports amoureux actuels et futurs et même l’ensemble de nos relations humaines. Elles proposent des pistes pour une conception réellement égalitaires et sensibles de nos rapports inter-personnels et intimes.
Cependant, certaines conceptions de A.K ont aussi des limites. Et même si celles-ci sont, pour une part, explicables par le contexte politico-social de son époque, il nous paraît essentiel de les critiquer. En particulier parce que ces idées ont eu et continuent d’avoir une influence plus ou moins néfastes sur la manière dont on a pensé et dont on pense aujourd’hui la révolution. Tout d’abord, on ne peut qu’être d’accord avec Judith Sora-Standor lorsqu’elle souligne le caractère « utopiste » de certaines positions de A.K. On l’a déjà souligné, cet aspect transparaît dans son analyse marxiste de l’évolution des rapports sociaux. Mais, ce caractère utopiste, on le retrouve encore plus lors de certaines conclusions politiques. En effet, parfois, on a l’impression que, pour la militante révolutionnaire, les luttes ouvrières et la mise en place d’une économie socialiste suffisent presque à elles seules pour résoudre la question de l’égalité entre les sexes. Chose étrange puisque son cheminement de pensée l’amène le plus souvent à envisager la lutte pour l’émancipation féminine et la lutte sociale comme complémentaires…
De même, dans ses textes datant de la révolution russe on perçoit un ton quelque fois « simpliste/ utopiste » et très enjoué. Parfois, elle n’hésite pas à parler de « paradis terrestre » pour qualifier le monde qu’elle souhaite et qui serait l’œuvre de la révolution prolétarienne… Cet enjaillement s’explique aussi par la période de la révolution russe qui est alors riche en potentialité révolutionnaire, surtout pour un acteur de premier plan comme A.K.
Par ailleurs, il peut heurter certains lecteurs plus actuels puisque nous vivons dans une période où la désillusion et le nihilisme sont très présents, y compris dans les milieux dits radicaux. Des sentiments pessimistes qui ne sont effectivement pas très fertiles pour se mobiliser et désirer un monde plus libre. Il n’en reste pas moins qu’on ne peut pas opposer à ces sentiments un utopisme trop simpliste qui n’est pas plus désirable… En effet, celui-ci peut produire un travestissement du réel et cache aussi, bien souvient, des manques au niveau de l’analyse et de la proposition politique.
Cet « utopisme » de la penseuse marxiste on le retrouve notamment dans sa nouvelle à la fin du bouquin qui évoque l’évolution des relations amoureuses en fonction du contexte politico-social, mais qui ne prend pas assez en compte divers aspect du réel.4
Enfin, lorsque l’on souhaite une révolution sociale réellement émancipatrice, il y a de quoi être en franc désaccord avec certaines de ses positions politico-sociales. Ces positions sont aussi davantage visibles dans ses écrits datant de la révolution russe. Premièrement, puisque A.K est léniniste, elle est aussi étatiste. Ainsi, la socialisation, la mise en commun des moyens de production et de consommation, sensés aider à la destruction de la famille, elle l’envisage comme l’œuvre de l’état. Or, que celui-ci soit prolétarien ou bourgeois, à la fin le résultat reste le même: la dépossession des moyens de régir nos existences au profit de classes et de concepts parasites.
Deuxièmement, Kollontaï, comme nombre de révolutionnaires de son temps, est pétrie de morale productiviste et d’idéologie du travail y compris vis à vis de la question des femmes:
« La république des travailleurs considère la femme avant tout, comme une force de travail, comme une unité de travail vivant » (p.220).
De même, elle a une vision encore très morale de la prostitution et parfois très traditionnel des rôles féminins. Clairement abolitionniste, vu que la prostitution est avec le mariage l’une des formes d’exploitation de la femme, elle utilise pour la décrire tout un vocable caractéristique de la critique de cette époque qui est moraliste et hygiéniste.
Enfin, alors que Kollontaï peut analyser et exprimer de manière assez clairvoyante la dialectique individu-collectif, au cœur du projet émancipateur communiste, elle fait parfois preuve d’un collectivisme niveleur voire totalitaire qui gomme cette même relation somme toute complexe. Par exemple, dans certains textes sur l’amour et la morale prolétarienne:
« […]la classe ouvrière subordonne l’amour des membres de la collectivité les uns pour les autres à un sentiment plus impérieux : l’amour-devoir envers la collectivité » (p.203).
« La morale prolétarienne prescrit: tout pour la collectivité. » (p.204).
Cette soumission de l’individualité à la collectivité, elle l’applique d’ailleurs à la femme et pas qu’à l’amour, montrant par là à quel point ces positions peuvent être dangereuses. Par exemple, lorsqu’elle évoque la maternité en URSS envisagée clairement comme un devoir social:
« Pendant neuf mois, elle cesse de s’appartenir à elle même, qu’elle est au service de la collectivité, qu’elle produit de sa chair et de son sang un nouveau travailleur. » (p. 222).
Voilà un passage qui remplirait de bonheur n’importe quel étatiste accompli. On peut d’ailleurs remplacer « collectivité » par « patrie » et « travailleur » par « soldat » pour voir aisément à quel point ce que ce genre de pensée peut avoir de commun avec d’autres mouvements autoritaires de type nationaliste ou fasciste par exemple.
Tous ces points de vue sont caractéristiques d’une certaine vision de la révolution et de l’émancipation par les bolchéviques russes et d’autres tendances révolutionnaires de cette période, y compris certaines tendances moins autoritaires. Il va de soi que ces présupposés contre-émancipateurs sont bons à jeter aux ordures de nos jours. D’autant plus que l’histoire du mouvement ouvrier et de la révolution russe nous ont largement prouvé leur invalidité tant théorique que pratique…
III] Forces du bouquin en soi
Le bouquin, en plus d’être un condensé de la pensée de Alexandra Kollontaï, a aussi un certain intérêt historique. Premièrement, il nous fait découvrir les positions d’une partie de la social-démocratie russe vis à vis de la question des femmes et du patriarcat. De même, on en apprend plus sur la condition de la femme et les rapport sociaux au début de l’URSS. Par exemple, les conférences de la penseuse, même si elles sont celles d’une dirigeante, nous livre des informations sur les rapports sociaux, la situation de la femme durant la période du communisme de guerre. Responsable des questions familiales, sexuelles et féminines, elle nous décrit divers changements dans la vie quotidienne et les mœurs soviétiques, la mise en place d’institutions collectives comme les cantines, les jardins d’enfants, les logements communautaires etc.
Mais, c’est davantage le travail de sélection et de présentation de Judith Sora-Standor qui nous en apprend plus sur la pensée bolchévik et la situation de la femme en URSS des années 20 aux années 60. Ce taf montre que les idées de Kollontaï ont toujours été minoritaires au sein du parti et que Lénine lui même était pétri de préjugés bourgeois sur la famille et la sexualité. De plus, après 1926, et la stabilisation du pouvoir bolchévik, il y a une tendance à la conservation de la cellule familiale en URSS. Par exemple, en 1936 l’avortement est aboli. S’appuyant sur l’analyse de Marcuse, Judith Sora-Standor estime alors que la socialiste soviétique post-révolutionnaire fonctionnait avec les mêmes présupposés que la société capitaliste. En effet, dans cette société l’individu était lui aussi envisagé seulement comme un producteur de biens. Les valeurs bourgeoises et soviétiques étaient alors très similaires. Elles se manifestaient et s’incarnaient dans une certaine morale du travail et sexuelle
Ainsi, dans les années 1960, la société soviétique était toujours une société patriarcale, dirigée par des hommes, où les tâches d’ordinaire dédiées au femmes, le ménage et les enfants, reposaient encore majoritairement sur elles. Le pouvoir soviétique, comme nombre d’autres états et pouvoirs autoritaires avant lui, a donc bien compris l’intérêt de conserver une cellule familiale stable ainsi que des mœurs « non dissolues » pour se maintenir en place et assurer le bon fonctionnement de son mode de production.
In fine, Kollontaï, bien que proposant des pistes en tant que femme et révolutionnaire pour abolir la famille bourgeoise, s’est vue opposer une fin de non recevoir par la majorité du parti et le cours de la révolution russe. En outre, elle aussi était parfois influencée par les principes idéologiques autoritaires, moralistes et productivistes propres à la pensée bolchévik. Par conséquent, elle n’a pas réussi à résister à la pression politico-morale des années 1920-1930. Le meilleur exemple de cette poussée réactionnaire se voit au travers de l’évolution du concept d’amour-jeu qui devient « l’amour camaraderie ». En effet, pour Judith Sora-Standor, avec cette nouvelle terminologie le
« contenu sexuel s’efface au profit du sentiment de solidarité envers la collectivité. La comparaison […] nous donne un assez bon aperçu de l’influence du puritanisme ambiant qui atteindra son apogée sous Staline. »
Charge à nous, sous tout ce fatras idéologique et « puritain », de dégager ce qui peut être bénéfique à des luttes plus contemporaines.
Notes
1 Friedrich Engels (1820-1895) est un révolutionnaire communiste allemand. En 1844, il rencontre Karl Marx avec qui il partage nombre de vues politiques notamment au sujet du socialisme et de la révolution. Il devient par la suite son grand ami et coécrit avec lui de nombreux ouvrages considérés dorénavant comme des classiques de la pensée marxiste, par exemple le Manifeste du parti communiste (1848). Souhaitant développer un mouvement révolutionnaire prolétarien, il milite au sein du mouvement ouvrier naissant, d’abord à La ligue des communistes puis à l’Association Internationale des travailleurs (AIT). Opposé, tout comme Marx, aux « anti-autoritaires » de l’AIT regroupés notamment derrière Bakounine, il participe activement à la scission de cette organisation et à son effondrement. Ayant à cœur de diffuser la pensée de son camarade auquel il survit, il rédige et publie les derniers ouvrages de Marx après sa mort. Son action sur la pensée de son ami est par la suite fortement critiqué par certains courants révolutionnaires communistes (par exemple : Maximilien Rubel, l’école de Francfort etc). En effet, il est parfois « accusé » d’être à l’origine du marxisme, c’est à dire de la fixation doctrinale de la pensée de Marx en une idéologie. Processus assez contradictoire puisque les développements de Marx et Engels se voulaient à la base critiques et destructeurs des idéologies…
2 August Bebel (1840-1913) est un militant et théoricien socialiste allemand. Membre du Parti social-démocrate d’Allemagne, il en est l’une des grandes figures et le dirige à partir de 1900. Il sera alors l’un des représentants du centre du Parti, entre la gauche de Luxemburg et les réformistes de Bernstein.
3 Les forces productives sont les éléments utilisés par les hommes pour produire leurs moyens d’existence ; elles sont composées de la force de travail du corps humain, force musculaire et nerveuse, et des moyens de production sur lesquels elle s’applique : d’une part, la nature elle-même, la terre, avec toutes ses ressources, et d’autre part, les outils, d’abord simples silex taillés qui ne cessent de se perfectionner, pour aboutir après des millénaires de progrès technique aux moyens de production modernes : les machines mues par une énergie naturelle qui n’est plus la force musculaire. Définition tirée de wikipedia
4 Cette nouvelle parle des relations et de la conception de l’amour qu’ont trois femmes de la même famille et de générations différentes et on va spoiler un peu pour étayer notre point de vue. La dernière femme de cette famille est née avant la révolution et vit sa prime jeunesse durant la révolution russe, à la période dites du communisme de guerre. A. K. la dépeind comme une femme ayant une conception de l’amour assez intéressante, n’étant pas portée sur les sentiments de jalousie, de propriété et faisant fi des normes morales bourgeoises dans la conception de ses relations intimes. Cette femme a des relations intimes-sexuelles avec le mari de sa mère (son beau-père). Ce dernier est plus jeune que la mère, ils sont tous les deux membres de la vieille garde bolchévique. Elle n’y conçoit pas de problèmes, ne voulant pas blesser sa mère qu’elle aime et ne voyant qu’une manière de relationner avec cet autre personne qu’elle apprécie aussi mais différement. Si on comprend que A.K veut nous montrer la différence dans la conception des relations que peut amener une révolution sociale d’ampleur chez trois générations différentes par cet exemple « non-conventionnel », on le trouve tout de même assez symptomatique de cet utopisme qui parfois la caractérise.
En effet, dans cette relation, A.K met seulement l’accent sur les valeurs de non-propriété et de camarederie hautement développées par cette femme, à tel point qu’elle ne conçoit pas que, par cet acte, elle peut, selon ses mots, blesser sa mère. Cette péripétie relationnelle ne nous paraît pas très proche du réel. En effet, les « relations » de ce type rentrent dans la catégorie de l’inceste, qu’il y est ou pas de liens biologiques entre les protagonistes. Or, dans le récit, il n’est pas fait jamais fait potentiel ascendant du mari sur sa belle-fille ou d’éventuels violences psychologiques et physiques qui peuvent avoir cours dans nombre de familles patriarcales.
La volonté de subversion sociale et morale de l’oeuvre perd donc en crédibilité car on a peine à imaginer qu’une révolution sociale et morale, même d’ampleur, amène aussi rapidement à ce type de situation où chaque protagoniste semble s’envisager à égalité alors que hier encore ils étaient enserrés dans un modèle familial plutôt traditionnel.
